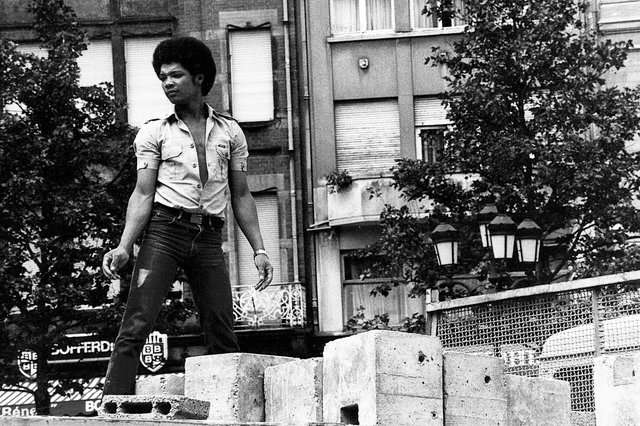Familialisme
L’action sociale au Luxembourg s’est développée selon une logique que l’on pourrait qualifier d’hygiéniste. Elle a souvent pris la forme d’une lutte contre l’insalubrité et les épidémies et pour l’extension des vaccinations (notamment des enfants). Après la Deuxième Guerre mondiale, dans l’imaginaire politique et sociétal, c’est la famille nucléaire qui devient l’élément central, l’ossature de la société. Plus que jamais, la famille est décrite comme « cellule de base » de la société assurant sa stabilité et sa cohésion. Les grandes sociétés sidérurgiques avaient introduit dès la Première Guerre mondiale des allocations familiales pour atténuer la pauvreté et la précarité qui touchaient surtout les familles avec enfants. Mais ce n’est qu’en 1947 que les allocations familiales sont généralisées. Et elles se développement rapidement. Dans le domaine associatif, on peut citer les créations de l’Action familiale et populaire en 1946, du Jongenheem en 1951 et du Kannerschlass au cours de la même année. En 1952 est créé le Conseil supérieur de la famille et de l’enfance. Par contre ce n’est qu’en 1965 que naît le Mouvement Luxembourgeois pour le Planning Familial. En 2021, les dépenses de la branche « famille » représentent près de quinze pour cent des dépenses sociales au Luxembourg contre un peu plus de huit pour cent dans l’Union européenne. À cela il faut ajouter les prestations familiales en nature, très développées.
Depuis l’industrialisation, la « famille », c’est-à-dire les structures familiales, a beaucoup (et très rapidement) changé : baisse de la natalité, famille nucléaire au lieu de la famille-souche, divorces en hausse, tout comme les cohabitations non-institutionnalisées… Néanmoins, dans les représentations et les perceptions, il reste une part de « traditionalisme », une sorte de « famille mythifiée ». Il est intéressant de noter que même aujourd’hui, et même chez des analystes qui se disent progressistes, la parenté et les « liens parentaux » sont représentés comme la quintessence du lien social, alors que le retour à un modèle familial « cohésif » semble être de l’ordre de l’utopie. L’apparition de notions comme « Eltere-Fürerschäin » – et ceci dans une société où les enfants vont souvent dans des crèches ou des maisons-relais1 – a des relents d’un paternalisme suranné (même si, évidemment, une parentalité sereine ne va pas de soi). Les années 1970 et 1980, en revanche, se caractérisent par une mise en cause radicale de l’ordre moral. Si on les place dans une perspective à long terme, ces années semblent plutôt correspondre à une parenthèse.
Entraide
D’autres associations issues de la société civile voient le jour dans les années 1950 et 1960, notamment dans le domaine de l’aide aux personnes en situation de handicap. En 1956 est créée la Ligue luxembourgeoise d’hygiène mentale qui s’inspire de la « Ligue française de prophylaxie et d’hygiène mentale » (1921) et de la « Ligue belge d’hygiène mentale » (1922). Cela montre deux constantes dans le domaine de l’intervention sociale au Luxembourg : Une ouverture aux évolutions internationaux, mais également un certain retard à l’allumage.
Toujours dans le domaine des personnes en situation de handicap, La Ligue HMC est fondée en 1963. Son objectif initial était la création de classes d’école pour les enfants en situation de handicap mental et cérébral. Quatre ans plus tard, d’autres parents créent l’APEMH, l’Association des parents d’enfants mentalement handicapés.
Les associations créées dans les années 1950-1960 ont donc une composante très forte d’’entraide mutuelle. On peut encore signaler, au cours de cette période, la naissance, en 1963, de l’Amiperas (Amicale des personnes âgées, retraitées et solitaires) qui répond en fait à l’évolution démographique structurelle qui commence à se dessiner, celle du vieillissement de la population. Dans le domaine de l’aide sociale proprement dite, on voit la création du Comité national de défense sociale (CNDS) en 1967.
Du familialisme aux droits de l’enfant et à la parentalité
Si années suivant la Deuxième Guerre mondiale sont donc caractérisées par un fort accent mis sur la politique familiale, on s’est orienté à partir des années 90 vers une accentuation du principe des droits de l’enfant. Les domaines de la protection de l’enfance et de l’aide à la jeunesse ont connu une activité législative assez intense. Le 10 août 1992 a été adoptée la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse et, en décembre 1993, la Chambre a ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989.2
L’Ombuds-Comité pour les droits de l’enfant, qui a vu le jour en 2002, devient l’Ombudsman fir Kanner an Jugendlecher (OKAJU) en 2020. Finalement, on doit mentionner la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Celle-ci consacre certains principes allant dans la direction d’un droit à une aide en cas de détresse, et crée l’Office national de l’enfance que d’aucuns considèrent aujourd’hui comme organisme bureaucratique centralisateur. Or, cette loi a laissé entière la législation sur la protection de l’enfance de 1992. Il en résulte une distinction artificielle (en termes de droits de l’enfant) entre aide à l’enfance et protection de l’enfance. On a formulé le problème ainsi : « Das sehr oft weitreichende Vorgehen des Jugendgerichts, welches meist erst aktiv wird, wenn die Situation der Familie bereits sehr instabil ist, wird durch die Trennung zwischen Jugendschutz und Jugendhilfe begünstigt. […] Die Trennung beider Themenfelder führt dazu, dass Minderjährige und ihre Familien teils in zwei Systemen – mit unterschiedlichen Methoden und Sozialarbeitern – an denselben Problemen arbeiten. »3 (Des projets de loi visant une harmonisation de l’aide à l’enfance sont actuellement en discussion.)
Parallèlement à la question des droits de l’enfant se développe le concept de parentalité. Des services d’information voient le jour. Comme le familialisme, la notion recèle une large part idéologique : « Symptomatique de profonds bouleversements, la notion de parentalité est aussi révélatrice des incertitudes qu’ils engendrent. Les débats autour de l’instabilité du couple parental, des parents démissionnant de leurs tâches éducatives ou des homoparents révèlent la multiplication des prescripteurs de bonne parentalité dans le champ social (éducateurs, professionnels de la santé, de la famille et de l’éducation, psychanalystes, pédopsychiatres, voire parents eux-mêmes). Ainsi perçue, la parentalité forme un ‘problème social’ et une nouvelle ‘question d’ordre public’. Elle reste donc, comme naguère la famille traditionnelle, un lieu fortement idéologique ».4
De l’explosion des années 1970…
Les années 1950-1960 sont marquées par un certain dynamisme au sein de la société civile, mais ce n’est rien par rapport à l’accélération foudroyante que le mouvement associatif va connaître dans les années 1970-1990. À cette époque naissent une pléthore d’organisations qui s’appuient sur l’engagement militant de leurs membres et se comprennent comme une sorte d’opposition extra-parlementaire aux politiques de l’État. Au Luxembourg, la parenthèse du gouvernement libéral-socialiste (1974-1979) a ajouté à la dynamique d’un secteur associatif militant. Dans les deux décennies suivantes, ces associations gardent le vent en poupe. Elles sont généralement « progressistes », s’opposant au conservatisme souvent identifié au CSV et au Luxemburger Wort. On peut ainsi citer, dans le domaine du développement, la création de l’Action formation des cadres qui deviendra l’ASTM (et dont est issu le centre de documentation Citim). Ses origines remontent à la fin des années 1960 et elle publiera à partir de 1973 le périodique Brennpunkt Drëtt Welt.
Dans les années 1970 se créent de nombreuses associations qui essaient de répondre aux nouveaux défis sociaux et sociétaux : place de la femme dans la société, migrants, drogues, milieu carcéral, psychiatrie, marché du travail et chômage structurel, etc. Les congrégations participent à ce mouvement. Les Sœurs de Ste Zithe s’étaient installées dans le quartier de la Gare en 1889 et s’occupaient à l’origine des jeunes filles cherchant un emploi de « domestique » et de soins ambulatoires, puis avaient ouvert une clinique après la Première Guerre mondiale. À partir de 1972, ces mêmes Sœurs vont gérer le Foyer St Martin à Eich qui accueille des travailleurs immigrés, pour créer en 1976 la « Maison de la Porte Ouverte » pour femmes en détresse (Foyer Paula Bové), puis en 1977, un foyer pour jeunes filles (Foyer St. Joseph).
À partir de 1979, l’association Inter-Actions s’attache d’abord à développer le travail communautaire social dans les faubourgs de la Ville, avant de s’intéresser également à l’insertion sur le marché du travail. L’association Femmes en détresse commence à travailler en 1979. Elle est issue d’un groupe de travail du Mouvement de libération des femmes qui avait été initié en 1971.5
En 1979 naît également l’ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés)6. Une des premières associations portugaises d’entraide, l’União-Centro Cooperativo Asbl, fut fondée dans les années 1970. L’existence d’un certain nombre d’associations (notamment l’ASTI et l’ASTM) est étroitement liée au « catholicisme de gauche » qui avait trouvé une sorte de refuge au 23, avenue Gaston Diderich chez les Jésuites. La paroisse des jeunes (« Jugendpor ») qui se développe à la même adresse fut également un des viviers du militantisme associatif. Encore aujourd’hui on en retrouve les anciens militants en tant que bénévoles au sein de nombreuses associations. La création de la publication Forum en 1976 se également situe dans ce contexte. La revue publie évidemment des critiques de l’Église « officielle », mais elle s’improvise également en véritable porte-parole d’un mouvement associatif militant extrêmement dynamique. Il suffit de lire les éditions du Forum des années 1970 et 1980 pour se rendre compte de cette vitalité.7
Des domaines considérés jusque-là comme marginaux par les pouvoirs publics se trouvent désormais sous le feu des projecteurs. À la fin des années 1970 naît aussi l’Action prisons, une association s’intéressant au sort des prisonniers. On peut également évoquer la création, en 1977, du Mouvement ATD Quart Monde à Luxembourg (qui devient une Asbl en 1981)8. Ce sont les Sœurs de la Doctrine chrétienne qui sont à la base des premières activités de cette association. Encore une fois, c’est une idée venant de l’étranger qui est à l’origine de cette création. Dans le quartier du Pfaffenthal (un quartier défavorisé à forte proportion d’immigrés) une aide aux devoirs d’école est mise en place, ensemble avec un groupe de lycéens. D’ailleurs, au début, il y a une collaboration très étroite entre Inter-Actions et ATD Quart Monde.
Finalement, la fin des années 1960 et les années 1970, voient l’essor des associations qui s’intéressent à la question écologique9 : Jeunes et environnement est créé en 1968, le Mouvement écologique est fondé informellement en 1978 et formellement en 1981. La lutte contre la centrale nucléaire de Remerschen (1973-1977) contribue à accentuer le militantisme dans ce domaine.
Il y a eu évidemment des créations d’associations importantes dans la période qui a suivi le bouillonnement des années 1970, comme la création de la « Stëmm vun der Strooss » (qui s’occupe des sans-abris) en 1996. On peut également mentionner Médecins du monde Luxembourg, fondée en 2013 et garantissant aux plus démunis un accès aux soins. Pour la plupart, ce sont des associations qui répondent à des besoins structurels qui se développent à partir des années 1980 (sans-abrisme, pauvreté, addictions, …). Une autre association qui reflète de nouvelles demandes sociétales est l’Asbl Rosa Lëtzebuerg, dont la création date de 1996. L’association défend les intérêts des personnes LGBTIQ.
Par ailleurs, le nombre d’organisations non-gouvernementales travaillant dans le domaine du développement (ONGD) augmente fortement depuis les années 1980. Le Cercle de coopération a vu le jour en 1979 et comptait six membres à l’origine. Aujourd’hui on en dénombre près de 90.10 La création du Cercle découle, lui aussi, d’un développement international. C’est la Direction de la coopération de l’Union européenne qui avait demandé de discuter avec un interlocuteur unique au Luxembourg ; encore un exemple de l’impact de l’évolution internationale sur le Luxembourg dans le domaine du tiers secteur
… au « bénévolat nomade »
Les années 1970-1990 sont donc marquées par différentes formes de militantisme allant du politique à l’associatif. Aujourd’hui il serait plutôt indiqué de parler de « bénévolat ». Comme l’a relevé l’économiste Danièle Demoustier, ce concept résulte de différents mouvements historiques, « de la laïcisation du paternalisme du XIXe siècle et des activités de charité basées sur un objectif d’ordre moral et politique, ainsi que de la dépolitisation des mouvements d’entraide ouvrière »11. Fondamentalement, on peut distinguer deux courants dans l’engagement associatif : La solidarité que l’on pourrait qualifier de mutualiste (entraide) et, d’autre part, l’engagement d’une classe plus aisée qui se penche sur une classe moins aisée12. Aujourd’hui le mouvement d’entraide continue évidemment d’exister, mais la conception du bénévolat répond actuellement plutôt à la logique philanthropique de la classe aisée qui aide la classe moins aisée.
Les comportements bénévoles changent aussi. Ils sont « plus éphémères, plus ponctuels, plus utilitaristes ». Le sociologue Jean-Pierre Worms parlait à ce sujet de « nomadisme associatif »13. Celui-ci concernerait d’ailleurs aussi bien les usagers que les bénévoles. Que le bénévolat soit une courroie de transmission importante de l’action sociale (privée et publique) ne fait guère de doute. Mais il s’est développé depuis une quinzaine d’années en véritable « marché du bénévolat » qui est le reflet plus global de l’économie de marché au sens néolibéral du terme. Les associations sont en compétition pour « récupérer » les bénévoles et les compétences des bénévoles. Pour cela, elles développent (ou sont obligées de développer) de véritables stratégies pour renforcer leur attractivité et leur compétitivité sur ce marché du bénévolat.
L’Agence du bénévolat, créée en 2002, est le reflet de cette évolution. D’après sa présentation sur Internet, l’agence « facilite la mise en relation entre votre organisation et les bénévoles » ; elle accompagnerait en outre les associations « pour améliorer la visibilité, la lisibilité et l’impact » de leurs annonces d’appel aux bénévoles. On ne peut s’empêcher d’y voir une véritable « bourse » du bénévolat. Si le travail des associations se professionnalise avec l’engagement de salariés ayant des compétences spécifiques, c’est également le bénévolat qui se spécialise. Il en résulte d’ailleurs, à l’intérieur des associations, une certaine ambiguïté concernant les fonctions des salariés et des bénévoles.
Du professionnalisme militant à la professionnalisation scolarisée
En parallèle au militantisme associatif des années 1970, on assiste à une professionnalisation de l’action sociale. Il s’agit en quelque sorte d’un « professionnalisme militant » qui s’impose. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, une génération de jeunes diplômés commence à rentrer au pays, que ce soient des psychologues, des assistant(e)s sociaux (sociales), des assistant(e)s d’hygiène sociale ou des éducateurs et éducatrices. Parfois ceux-ci ont des liens d’amitié ou de visions professionnelles similaires. Inter-Actions en constitue un des exemples. C’est le résultat d’une initiative commune de quelques assistant(e)s sociaux (sociales) rentrant à la même époque de l’université ou d’écoles d’enseignement supérieur. En 1978 est créée l’ANCE, l’Association Nationale des Communautés Éducatives (qui devient, en 2011, l’ANCES), qui diffuse un bulletin14 qui relaie au Luxembourg les savoirs et pratiques innovantes d’autres pays.
À la même époque, on assiste à une sorte de « relocalisation » des professions socio-éducatives, même si beaucoup de jeunes continuent à choisir l’étranger pour leurs études. En 1974 est créé l’IFEM, chargée de former les éducateurs. Cinq ans plus tard, les études et les attributions de la profession d’assistant social sont réglementées. En 1990, l’Institut d’études éducatives et sociales (IEES) voit le jour. Il devient le Lycée Technique pour Professions Éducatives et Sociales en 2005. La création de l’Université du Luxembourg (en 2003) accentue la professionnalisation « nationalisée » des métiers éducatifs et socio-éducatifs. Dès 2003, un bachelor en sciences sociales et éducatives est créé, suivi, en 2011, d’un master intitulé « Management und Coaching im Bildungs- und Sozialwesen ».
Que la formation au Luxembourg puisse concourir avec des formations à l’étranger est peu discutable. Néanmoins, il manque peut-être le contact avec le dynamisme des initiatives sociales à l’étranger. (Celles-ci sont parfois très innovantes, notamment dans les grandes villes.) Il va sans dire que les enseignants à l’Université du Luxembourg ne font pas l’impasse sur les évolutions internationales. Mais s’y frotter directement peut s’avérer crucial dans des professions où l’engagement est peut-être aussi important que le parcours scolaire.
L’État contrôleur ?
C’est à partir du milieu des années 1970 que se développe la pratique du conventionnement. Elle est notamment une réponse aux difficultés financières rencontrées par les associations catholiques et les congrégations dont les ressources humaines commencent à se tarir. Le conventionnement conduit à des mutations au sein du tiers secteur. On constate un pullulement assez incontrôlé des associations actives dans le domaine social et notamment parmi les ONGD. De nouveaux chantiers sociaux s’ouvrent, auxquels le mouvement associatif répond par de nouvelles initiatives. Certains acteurs étendent leurs activités jusqu’à couvrir parfois l’intégralité du champ de l’intervention sociale (allant du surendettement aux maisons-relais, en passant par l’aide aux sans-abris, etc.). Ces véritables conglomérats, comme Caritas, la Croix-Rouge, Inter-Actions, deviennent des acteurs systémiquement indispensables (occupant des centaines de personnes). De facto, ils sont « too big to fail »15. Quoi que l’on puisse penser de la reprise des activités de Caritas par « Hëllef um Terrain » (HUT), il était et il est impensable que toutes ces activités ne soient pas continuées avec l’aide de l’État.
Le subventionnement obéit à un principe de base, à savoir la recherche d’un équilibre de financement et de subventionnement entre les acteurs importants de la société civile, notamment entre Caritas, Croix-Rouge, Inter-Actions, Elisabeth. Et cela sans que l’on puisse déceler une véritable priorisation de la part des pouvoirs publics.
Au Luxembourg, le champ de l’aide sociale « sur le terrain » est aujourd’hui largement entre les mains d’associations (le plus souvent conventionnées par l’État). Ce fait ne doit pas cacher qu’au XIXe siècle et jusque dans les années 1970, c’était plutôt l’État qui apportait l’innovation dans ce domaine. Qu’en est-il aujourd’hui ? On ne peut pas dire que l’État ait fui toute forme d’autoréflexion sur ses activités sociales. En témoignent les nombreux (nous en avons dénombré sept) « Conseils supérieurs » qui ont été créés à partir de 1952 dans le domaine social, éducatif et socio-économique. Ils reflètent les principes du modèle luxembourgeois de concertation et de consensus entre partenaires sociaux (ici entre État et associations). Mais certains de ces Conseils laissent peu de traces écrites sur leurs activités. Deux autres évolutions parallèles accompagnent cette volonté de concertation : La création des divers « observatoires » (chargés de faire des analyses) d’une part, et de services centralisateurs et de contrôle d’autre part.
En réalité, l’État a toujours fait des efforts de coordination (à travers les comités interministériels, par exemple). Avec la création des offices nationaux, on entre dans une nouvelle ère où les motivations d’innovation (observatoires) et de contrôle (offices nationaux) coexistent. Avec, évidemment, un risque de bureaucratisation.
D’une manière générale, l’évolution du tiers secteur au Luxembourg pose implicitement la question des frontières entre secteurs. Cette question centrale a été et est peu discutée au Grand-Duché. Or, le brouillage de la frontière public-privé (dans le domaine économique, comme dans le domaine social), « met aussi en jeu les conditions mêmes dans lesquelles se définit l’intérêt général », écrivent Antoine Vauchez et Pierre France16. Les deux chercheurs plaident en faveur des frontières clairement tracées : « L’émergence d’un espace démocratique a été rendue possible par la formation d’un ensemble de frontières, toujours incertaines, toujours contestées, qui ont permis d’asseoir l’autonomie relative de la sphère publique. Cette protection du public à l’égard de la tyrannie des secteurs adjacents (religieuse, militaire, économique, ou autres) ou, pour le dire autrement, cette politique du containment qui les tient à distance des espaces de délibération de l’intérêt général est une condition sociale et institutionnelle de l’égal exercice et de l’égale jouissance des libertés politiques. »17
L’absence de travaux sur la structure générale du tiers secteur au Luxembourg est problématique. Comment y remédier ? En France, il existait pendant un temps un Conseil d’analyse de la société (CAS), organisme gouvernemental auprès du Premier ministre, ayant pour mission « d’éclairer les choix politiques du gouvernement par l’analyse et la confrontation des points de vue, lorsque les décisions à prendre présentent des enjeux liés à des faits de société ». Signe des temps, ce conseil (créé en 2004) fut supprimé en 2013 et intégré dans Commissariat général à la stratégie et à la prospective (France Stratégie). Avant d’être dissoute, le CAS avait produit un rapport sur « la représentation du monde associatif dans le dialogue civil ». L’affaire Caritas ne pourrait-elle pas devenir le déclencheur d’une analyse similaire pour le Luxembourg ?