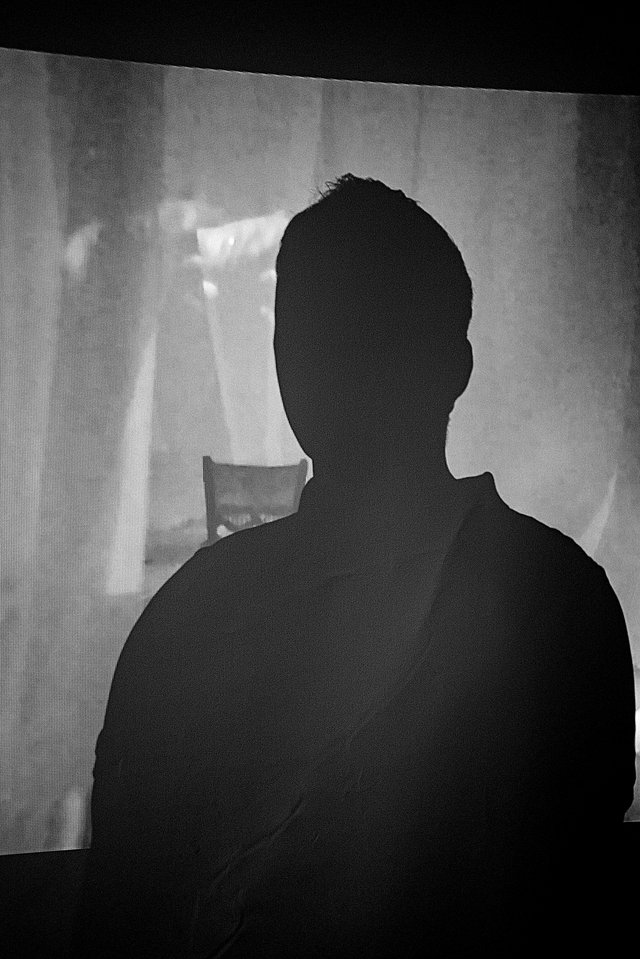Dans un tiers des pays du monde, principalement en Afrique et en Asie, les relations homosexuelles demeurent interdites. Ces relations sont passibles de prison voire, dans une dizaine de pays, de peine de mort, selon un rapport de l’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes. Dans leur pays, les homosexuels vivent cachés. Bien souvent, quand leurs familles ou leurs proches découvrent leur orientation sexuelle, ils subissent du rejet, des brimades, des humiliations, des violences physiques et sexuelles. Beaucoup n’ont pas d’autre choix que de fuir. S’en suit un long exil vers l’Europe, souvent semé de violences. Une fois sur le sol européen, ils sont confrontés au parcours de la demande d’asile, où ils doivent raconter leur intimité. Ils risquent aussi d’y être discriminés, écartés et harcelés par la communauté de leur pays d’origine.
Au Luxembourg, les autorités ne recensent pas les demandes d’asile motivées par l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, ni les caractéristiques sexuelles (ce que désigne l’acronyme officiel OSIEG, ou SO-GIESCS en anglais). Le ministère de l’Intérieur et son département de l’Immigration ne tiennent pas de registre sur les raisons de la demande de protection internationale. Les statistiques mensuelles n’indiquent pas si les personnes fuient la guerre, des persécutions politiques ou des menaces liées au genre et à la sexualité. Aucun chiffre ne permet non plus de connaître le taux d’acceptation des demandes d’asile LGBTI+, ni leur présence dans les structures d’accueil.
Quelques indices cependant. En 2022, le centre LGBTIQ+ Cigale a lancé un groupe de soutien et d’empowerment pour les réfugiés queer. Environ cinquante personnes figurent sur la liste de diffusion Whatsapp, et une vingtaine participent activement aux rencontres et aux ateliers. De son côté, le Rainbow Center note une augmentation des visites de demandeurs de protection internationale « Il s’agit en général de gays isolés, sans contacts dans la communauté. Ils cherchent du soutien, des conseils. Ils nous trouvent car notre centre est visible », explique Kusaï Kedri, chargé de projet. Le magazine queer.lu a d’ailleurs consacré son édition hiver 2025 à ces questions sous le titre « Not safe enough ».
Parmi les personnes accueillies au Rainbow Center, Sam (prénom modifié) a accepté de partager son histoire. Ce juriste de 32 ans vient de Lattiquié, une ville portuaire de Syrie à forte population chrétienne, dont la famille de Sam. Il cache son homosexualité depuis toujours : « Mes parents sont très religieux, c’est inconcevable pour eux. » Doublement menacé dans son pays, en tant que chrétien et en tant que gay, il décide de fuir quand il est appelé à l’armée. Attiré par la promesse d’un passage facile vers l’UE, Sam arrive d’abord en Biélorussie, pas franchement un pays gay friendly. Comme d’autres, il se retrouve piégé dans les forêts entre les soldats biélorusses et l’armée polonaise, confronté à des conditions de vie inhumaines. « J’ai mis plusieurs mois à réussir à traverser, en parcourant presque 300 kilomètres à pied. » Finalement, il arrive au Luxembourg dans un van avec des Ukrainiens, en juillet 2023.
Lors de son entretien au ministère, Sam tait son homosexualité. « Je ne veux pas que cela se sache. Je refuse de parler de ma vie sexuelle », explique-t-il. Une attitude très courante comme le souligne un rapport du Défenseur des droits en France (Les demandes d’asile en raison de l’orientation sexuelle : comment prouver l’intime ?) : « Des nombreux demandeurs d’asile LGBTI+ ne révèlent pas leur orientation sexuelle ou leur identité de genre directement à leur arrivée. Les raisons sont, notamment, le traumatisme, le manque d’informations sur les motifs de protection ou la méfiance générale à l’égard des autorités en raison des persécutions subies dans le pays d’origine. » Maud Théobald, directrice adjointe de Cigale confirme : « Le retard dans le récit est souvent l’expression d’une difficulté à dire son homosexualité dans un contexte de persécution sociale et de répression religieuse. L’accompagnement individuel et collectif permet peu à peu de dépasser la honte et l’homophobie intériorisée. »
« Une déclaration tardive du statut OSIEG constitue l’un des motifs les plus fréquents de rejet des demandes d’asile », précise Fiona Lenert de Passerell. L’association fustige aussi l’évaluation des risques de persécution dans les pays d’origine. Ainsi, le Ghana, la Géorgie et le Maroc sont listés comme « sûrs » alors qu’ils maintiennent des lois répressives contre les personnes LGBTI+. Les éléments objectifs (législation, presse du pays d’origine, analyses d’ONG internationales...) concernant la situation des homosexuels et transgenres dans les pays d’origine, indispensable pour établir une « présomption de persécution » sont souvent lacunaires.
Le « défaut de crédibilité » revient également comme un motif de rejet. Prouver son orientation sexuelle ne va pas de soi surtout pour ceux qui l’ont cachée ou niée toute leur vie. Ils doivent raconter leur histoire et apprendre à mettre des mots sur leur intimité, devant un inconnu. Les interrogatoires portant sur les détails des pratiques sexuelles du demandeur sont interdits, tout comme des examens physiques et psychologiques invasifs qui ont pu avoir cours par le passé. Néanmoins, l’agent chargé de l’entretien risque de projeter des représentations culturelles qui nuisent à l’évaluation. « Les questions autour de la prise de conscience, du vécu ou des émotions traduisent souvent une vision occidentalisée de l’orientation sexuelle, y compris des notions stéréotypées associées aux homosexuels », ajoute la directrice adjointe de Cigale.
Morgan a choisi une autre voie que Sam : « Dès le premier entretien, j’ai expliqué clairement que je risquais ma vie dans mon pays à cause de mon homosexualité. » Ce Camerounais de 22 ans est arrivé au Luxembourg en 2022. Il a obtenu le statut de réfugié il y a un an et coordonne aujourd’hui le groupe « Réfugiés queer » de Cigale. Pour préparer l’entretien décisif, Morgan a collaboré pendant plusieurs mois avec une assistante sociale et un avocat. « Le demandeur de protection internationale doit donner un récit aussi complet et étayé que possible », détaille Maud Théobald. Elle rédige des attestations et des témoignages détaillés sur la participation des requérants aux activités de Cigale. « Garder des photos ou des applis de rencontre dans mon téléphone représentait un danger dans mon pays. Pour mon dossier, j’ai préféré prouver mon engagement à travers ma participation dans l’association », raconte Morgan. Fort de son expérience, il conseille désormais les autres membres du groupe. « Je leur dis de rester prudents, d’éviter de provoquer ou de se mettre en danger. Mais aussi de ne pas mentir, de s’entourer de personnes confiance pour sortir et être eux-mêmes. »
Le groupe « Réfugiés queer » ne compte qu’une demi-douzaine de femmes. « C’est encore plus difficile et plus dangereux pour elles », note Maud Théobald. À 29 ans, Lydia se montre très active au sein de Cigale. Arrivée de Grèce en octobre 2024, cette Ougandaise a subi des persécutions dans son pays du fait de son homosexualité. Elle prépare son dossier en vue de l’entretien pour sa demande d’asile et rassemble des preuves : « Je n’ai plus de messages ou de photos de ma compagne car la police ougandaise a pris mon téléphone. Mais j’ai des documents qui montrent que j’ai participé à la Pride en Grèce ». Elle espère que cela suffira.
Malgré des parcours différents, Sam et Morgan racontent des réalités similaires dans les foyers d’accueil. « Les personnes LGBTI+ sont souvent victimes de harcèlement, d’isolement et de discrimination de la part des autres demandeurs d’asile. C’est une sorte de double peine : ils taisent et cachent leur identité dans les foyers alors qu’ils doivent l’affirmer et la revendiquer dans les interviews pour obtenir le statut », note
Kusaï Kedri au Rainbow Center. « On se retrouve entouré des mêmes gens que ceux que l’on a fui », pointe Sam. Tout comme il a caché son orientation sexuelle, il a caché la croix qu’il portait au cou. « Je reste le plus souvent seul, à l’écart, je donne seulement un coup de main pour des traductions », indique-t-il. Ayant annoncé son homosexualité ouvertement auprès des travailleurs sociaux du foyer, Morgan a vécu dans la peur. « Un homme trans, hébergé dans le même centre, a subi de mauvais traitements. Je me suis terré, je suis resté seul en évitant tout contact. » Tous les deux ont été hospitalisés pour leur état dépressif. « Le psychiatre a signalé ma vulnérabilité liée à mon orientation sexuelle. Maintenant que les assistants sociaux sont au courant, j’ai encore plus peur. Je vois les gens de la sécurité qui font des commentaires dans mon dos », s’emporte Sam. Il a demandé de changer de foyer. Ce qui ne lui a pas encore été accordé. Après son hospitalisation, Morgan a été admis dans un foyer plus petit, où sont hébergées des personnes malades ou vulnérables. «Quand les violences sont avérées, l’ONA réagit assez vite», note Maud Théobald.
Ces témoignages rappellent l’importance d’une formation adaptée pour les agents en charge des demandes de protection et les travailleurs sociaux des foyers. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile dispense un programme intitulé « Gender, gender identity and sexual orientation ». Cigale a également mis en place une formation spécifique qu’elle souhaite plus systématique et élargie. « Parfois, un simple détail suffit à créer un climat de confiance. Un pin’s arc-en-ciel, par exemple, envoie le message : tu es en sécurité avec moi », souligne la directrice adjointe. p